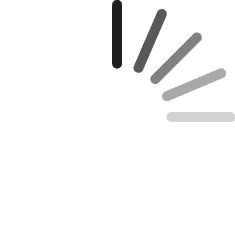Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Ardennes
Ariège
Aude
Aveyron
Bas-Rhin
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Côte-d'Or
Côtes d’Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Essonne
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Gironde
Haute-Garonne
Haute-Loire
Haute-Saône
Hautes-Pyrénées
Haute-Vienne
Hauts-de-Seine
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Landes
Loire-Atlantique
Loir-et-Cher
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Mayenne
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Paris - Notre-Dame
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Rhône
Saône-et-Loire
Sarthe
Tarn
Tarn-et-Garonne
Val d'Oise
Vaucluse
Vendée
Vienne
Yonne
Yvelines
Actualité de la base Muséfrem
Vous avez dit prosopographie ?
Histoire de l'enquête Muséfrem
Les fondements de l'enquête Muséfrem
Les contributeurs depuis 2003
Les partenaires scientifiques
Contact
Pour citer Muséfrem
Musique et musiciens d’Église dans le département du TARN-ET-GARONNE autour de 1790
Montauban : vue panoramique depuis le Pont Vieux sur le Tarn. Au 1er plan, le musée Ingres (ancien palais épiscopal du XVIIe s) et le clocher de l’église Saint-Jacques (XIIe s). À l’arrière-plan, en hauteur, la cathédrale Notre-Dame-de-L’Assomption, construite à partir de 1692. (cl. Photothèque Peuriot-Ploquin)
Le Tarn-et-Garonne n’est pas né en 1790, mais seulement en 1808. Pascale Marouseau, directrice des Archives départementales, présentait ainsi cette naissance tardive lors de la commémoration de son bicentenaire : Montauban « qui occupait la troisième place du Midi Aquitain, ancien siège de généralité, de cour des aides et de gouvernement militaire » n’est plus, depuis 1790, que le chef-lieu d’un district du Lot. Toulouse et Cahors triomphent. Montauban est consternée, humiliée, mais ne s’avoue pas vaincue. En 1806-1807, l’empereur Napoléon Ier se montre assez disposé à réparer une injustice. La réception exceptionnelle que les Montalbanais lui offrent lors de sa visite du 29 juillet 1808 achève de le décider. Aussi, le sénatus-consulte du 4 novembre suivant crée un département avec Montauban comme chef-lieu. Le décret du 21 l’organise. Castelsarrasin, chef-lieu d’arrondissement en Haute-Garonne, le devient dans le nouveau département et Moissac, qui était simple chef-lieu de canton depuis 1790, obtient également ce statut. Ainsi, le Lot rend au nouveau département l’arrondissement de Montauban et la Haute-Garonne celui de Castelsarrasin, tandis qu’on complète le territoire par quelques cantons prélevés sur les départements adjacents du Lot-et-Garonne (Valence, Auvillar et Montaigu), du Gers (Lavit) et de l’Aveyron (dont Saint-Antonin-Noble-Val). Seul le Tarn échappe à tout transfert. Le premier préfet peut entrer dans sa préfecture. Et Pascale Marouseau de conclure : « Si le Tarn-et-Garonne avait été créé comme ses voisins en 1790, nul n’aurait songé à en souligner la composition hétéroclite, qu’il partage avec d’autres départements. Aujourd’hui, c’est avec amusement que le benjamin des départements savoure ce caprice de l’histoire ».
Du fait de cette histoire, le contenu de la série L des archives départementales est très mince. En particulier, les dossiers, liés aux demandes de pensions par les musiciens et les chantres dans les premières années qui suivent la suppression des chapitres et la fermeture des églises, reposent dans les départements limitrophes. Fort heureusement, l’enquête MUSEFREM y a fait resurgir un nombre important de documents. Ainsi, par exemple, le dossier de carrière du dernier maître de musique de la cathédrale de Montauban, Louis AMIEL, est conservé aux archives de Haute-Garonne. Mais beaucoup d’informations, y compris sur des musiciens dont nous ne connaissons que le patronyme, n’ont pas encore été retrouvées.
I – LE TERRITOIRE DU « BENJAMIN DES DÉPARTEMENTS »
Le Tarn-et-Garonne est l’un des plus petits départements de France avec ses 3 720 km2. Il est situé au nord-ouest de la région Occitanie, et borné du nord au sud par le Lot, l’Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne et le Gers. À l’ouest commence la Nouvelle-Aquitaine avec le Lot-et-Garonne comme département limitrophe.
Le diocèse de Montauban d’Ancien Régime a bien entendu disparu en 1790, puisque la nouvelle règle imposait partout la superposition territoriale du département et du diocèse. En créant le Tarn-et-Garonne, Napoléon établit le diocèse de Montauban. Ce nouveau diocèse, qui est presque trois fois plus étendu que celui qui l’avait précédé, provient de fragments issus de huit diocèses d’Ancien Régime, ceux de Montauban, Toulouse, Cahors, Agen, Rodez, Lectoure, Condom et Lombez. De la même façon, le nouveau département regroupe des morceaux de trois anciennes provinces : le Languedoc au sud et au sud-est, la Guyenne au niveau du Rouergue, du Quercy et de l’Agenais, et enfin la Gascogne au sud-ouest.
• • • Un pays de plaines bordées de plateaux et de collines
Bien que ce département présente une grande diversité de paysages, le schéma d’ensemble est simple. Il s’agit de « six petits pays [qui] font la ronde autour des plaines », lit-on dans l’Atlas de Tarn-et-Garonne paru en 1999. Les plaines alluviales de la Garonne et de ses deux affluents de la rive droite, le Tarn et l’Aveyron, occupent l’intérieur. Le fleuve Garonne descend de la chaîne des Pyrénées, arrose Toulouse, puis traverse le nouveau département du sud-est vers le nord-ouest, avant d’aller rejoindre Bordeaux. Toutes ces plaines forment un seul ensemble gorgé d’alluvions et unifié par de faibles altitudes. Le contraste est net avec les collines du Monclar tournées vers le Languedoc et celles de la Lomagne qui prolongent le Lannemezan pyrénéen. À l’est, le Massif Central est présent continument. Plus au nord, le Rouergue pénètre jusqu’à la vallée profonde de la Bonnette, qui est un affluent de l’Aveyron aux gorges profondes, ainsi que l’ancienne frontière historique avec la province du Quercy. Ce dernier s’avance dans le nord sur une large profondeur : c’est le Bas-Quercy. Il se caractérise par le calcaire de son sous-sol dont la perméabilité rend les sols très secs en été. Les nombreux cours d’eau y ont creusé et élargi les vallées. Les plateaux et collines présentent des aspects bien différents. Néanmoins, les altitudes y demeurent modestes puisque le point culminant du département, qui se situe à la limite du Quercy et du Rouergue, au Pech Maurel, n’atteint que 510 mètres.
Mais en vain cherche-t-on des espaces uniformes et monotones, que ce soit dans la basse région alluviale ou bien dans ces petits territoires hérités des montagnes régionales. L’Atlas du Tarn-et-Garonne en a relevé les caractéristiques sur l’ensemble du département. D’abord, « à la rencontre des collines et des plaines, se trouvent les rubans de hauts côteaux qui courent sur des km ». Puis, « dans l’immense cœur plat du département […], de modestes accidents marquent le paysage : ce sont les rebords de terrasses, ou talus. Ces talus […] cristallisent le bâti qui est venu s’y percher pour échapper aux montées dévastatrices des eaux. C’est sur eux que s’égrène ainsi tout un chapelet de bourgs, trame urbaine des plaines ».
Au centre du département, là où les eaux du Tarn et celles de la Garonne se préparent à confluer, se trouvent les agglomérations les plus importantes : Montauban, Castelsarrasin et Moissac. Les petites villes sont également nombreuses, bien réparties dans l’espace. Ainsi, au nord d’une ligne Montauban – Moissac, citons, d’est en ouest, Caussade, Montpezat-de-Quercy, Molières, Lafrançaise, Lauzerte et Montaigu-de-Quercy. Au sud de Montauban, nous rejoignons le cours de la Garonne qui, depuis la ville portuaire de Verdun(-sur-Garonne) et jusqu’à sa sortie du département, égrène petites villes et villages sur les hauteurs qui la surplombent. Le réseau intérieur présente quelques gros bourgs, tel Beaumont-de-Lomagne.
Les inondations ont toujours été redoutées, d’où des bourgs et villages perchés au-dessus des parois abruptes des vallées, autant à l’abri des invasions que de la montée soudaine des eaux. Les habitants des plaines avaient construit sur des terrasses naturelles ou sur des monticules qui avaient survécu à l’érosion. Mais les faubourgs plus récents sont descendus vers les parties basses. Sur les plateaux entaillés du Bas-Quercy, le souci était le même. Aussi, les prairies occupaient-elles souvent les terres basses de la vallée, tandis que les cultures et les arbres fruitiers poussaient sur les pentes et que les habitations étaient au-dessus.
• • • Une économie principalement agricole
Au mois de juin 1787, l’Anglais Arthur Young voyageait sur la route de Montauban à Toulouse, c’est-à-dire en plaine. Il admirait « les plus beaux champs de blé que l’on puisse voir ». En effet, ce territoire était un véritable grenier de céréales. La culture du maïs y avait connu une forte expansion tout au long du XVIIIe siècle. Ce « gros millet », comme on l’appelait, entrait surtout dans les cultures de subsistance, réduisant ainsi la consommation du blé. Tout au contraire, la récolte du blé était lucrative, et donc commercialisée. Il s’agissait d’un grain bien dur dont les grands moulins des minotiers urbains extrayaient une excellente farine, fine et sèche. D’après P. Deffontaines, il y avait à Montauban, en 1786, « trente-cinq maisons produisant 120 000 barils et occupant 1 800 ouvriers ». Cette activité, concentrée sur le faubourg de Sapiac, occupait « un bon millier d’ouvriers tonneliers à la fabrication des barils » (Deffontaines, 1929). Sans compter, bien entendu, les charpentiers employés à la construction et à l’entretien des bateaux. Une proportion importante de cette farine partait pour Bordeaux et était exportée vers les « Isles », c’est-à-dire vers les colonies des Antilles. Tout au contraire, la polyculture pratiquée sur les plateaux et collines donnait une place beaucoup plus large aux productions d’autosuffisance. C’était moins le blé roi que le trio blé, avoine, millet, ainsi que les moutons et les plantes textiles.
Les bateaux descendaient la Garonne ainsi que le Tarn en aval de Montauban. Et les routes ? Arthur Young dit avoir apprécié « la route qui mène à Caussade bordée par six rangées d’arbres, dont deux de mûriers d’arbres ». Au sud de Montauban, en direction de Toulouse, il a noté « la route bien construite et empierrée avec du gravier ». Comme dans le reste du royaume, les chemins de grande circulation ont été refaits et d’autres créés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Young voyageait sur la grande voie des postes et messageries qui franchissait enfin l’Aveyron par un pont et non plus par des bacs. Une seconde voie traversait déjà d’est en ouest, conduisant de Montauban jusqu’à Bordeaux, par Moissac et Agen. Enfin, la Grande Route du Rouergue, depuis Montauban et Caussade, partait vers l’est en direction du Languedoc. Mais seules les petites villes placées à proximité de ce réseau moderne, telle Caussade, profitaient du progrès.
• • • Un espace durablement marqué par les guerres de Religion
En 1790, l’espace du futur département de Tarn-et-Garonne ne manque pas d’atouts. Mais sept décennies de guerres de religion l’ont profondément meurtri. Bien peu de villes et villages, qu’ils soient entrés dans le camp protestant ou demeurés catholiques, ont échappé au cataclysme. Montauban a été gouvernée par les protestants à partir de 1561. Elle n’a été reprise en main par les catholiques et le pouvoir monarchique qu’en 1629, en dépit d’accords éphémères ou d’épisodes terribles, comme les trois mois de siège tenus en 1621 par l’armée royale et Louis XIII en personne. C’était un bastion protestant jugé imprenable qui rayonnait sur le monde protestant avec son collège fondé par Henri de Navarre dès 1579, puis l’académie construite quelques années plus tard dont la section théologique intéressait les étudiants français et même quelques étrangers. Que trouva Richelieu en 1629 ? Les ecclésiastiques, moines et religieuses en fuite, les églises, y compris la cathédrale Saint-Théodard, détruites, excepté Saint-Jacques qui, cependant, avait subi de gros dégâts. Ce fut donc dans cette église que se déroulèrent les célébrations épiscopales pendant 90 années, c’est-à-dire jusqu’au terme du long processus de reconstruction de la cathédrale et de la reconquête catholique.
II – MONTAUBAN, UNE CAPITALE RÉGIONALE SUR LES BORDS DU TARN
Montauban a été, jusqu’à la Révolution, le siège d’un évêché créé en 1317 et l’est redevenu en 1808. En 1790, avec une population évaluée entre 26 000 et 30 000 habitants, c’est l’une des trois grandes villes régionales, aux côtés de Toulouse et de Bordeaux, dont elle est distante, respectivement, de 50 et 200 km. Mais elle est située à la périphérie de son diocèse : depuis 1144, date de sa fondation par le comte Alphonse de Toulouse, elle marque la limite septentrionale de la frontière historique du Languedoc, tout en étant une cité importante, mais très excentrée, du Quercy.
En 1317, quand le pape Jean XXII créa le diocèse de Montauban, il fallait établir une cathédrale. Ce fut l’abbaye bénédictine de Montauriol, bâtie au IXe siècle en surplomb du Tescou, un petit affluent du Tarn, qui fut élevée à ce titre. Il faut dire que le comte de Toulouse avait, deux siècles plus tôt, fondé sa ville de Montauban à très faible distance de cette abbaye qui, après avoir été sous le patronage de Saint- Martin, avait opté pour celui de Saint-Théodard, un évêque mort en odeur de sainteté. Mais en 1317, elle relevait de l’abbaye de la Chaise-Dieu. Qu’à cela ne tienne ! Le pape lui rendit son indépendance. Son abbé pouvait alors devenir le premier évêque et ses moines les chanoines du nouveau chapitre cathédral. En revanche, les dimensions du diocèse, qui n’englobait que 90 localités, étaient modestes.
• • • Une ville florissante, capitale religieuse et culturelle
Au XVIIIe siècle, cette ville est devenue, dit-on, l’une des plus belles du royaume. « Elle est bien percée et assez bien bâtie », écrivait en 1766 l’abbé Expilly. Une vingtaine d’années plus tard, Arthur Young abondait en ce sens : « Montauban est une vieille ville, mais qui n’est pas mal construite […]. On dit qu’elle est très peuplée, et ce que l’on en voit confirme cette information. La cathédrale est moderne et vraiment bien construite, mais trop lourde, le collège public, le séminaire, le palais épiscopal, la maison du premier président de la Cour des Aides sont de beaux bâtiments, cette dernière avec une entrée très fastueuse. La promenade est joliment située, construite sur la partie la plus élevée des remparts, et dominant cette noble vallée, ou plutôt cette plaine, l’une des plus riches de l’Europe », qui s’étend jusqu’à la mer et jusqu’aux Pyrénées, explique ensuite le voyageur anglais.
Montauban est à une quinzaine de kilomètres en aval de la confluence de l’Aveyron et du Tarn, comme à l’abri des collines qui réunissent les deux vallées. Le quartier central de la ville, que Young évoque, s’est formé au Moyen Âge sur un éperon qui sépare les deux petits affluents du Tarn, le Tescou, le plus connu, et le Lagarrigue. La ville est ensuite descendue jusqu’aux eaux du Tarn et ses faubourgs qui se sont étalés sont en pleine croissance, alimentés par une immigration forte et continue. Mais les inondations restent des menaces récurrentes, à l’image de celle de 1766, lorsque les trois faubourgs de Sapiac, de Gasseras et de Villebourbon, où se trouve de nos jours la gare SNCF, sont submergés par le Tarn en crue, la population ouvrière et artisanale sinistrée, les maisons et fabriques effondrées, les moulins endommagés, etc. De ces poumons économiques à reconstruire, s’échappèrent les rescapés auxquels les habitants de la « Ville » offrirent l’hospitalité (Caminel, 1766).
À l’opposé des autres villes et bourgs de ce diocèse qui ont beaucoup peiné pour retrouver un bon équilibre après les conflits religieux, Montauban en a perçu immédiatement un grand profit. En effet, Louis XIII, puis Louis XIV, ont tenu à faire de ce chef-lieu d’évêché, échappé de son giron pendant trois quarts de siècle, le symbole de la reconquête catholique et de la toute-puissance de la monarchie. Ainsi, Montauban s’est-elle métamorphosée, profitant d’une réorganisation administrative. Il y eut d’abord, dès 1635, la généralité de Montauban qui est demeurée immense jusqu’en 1716, avant d’être réduite aux deux provinces du Quercy et du Rouergue. La Cour des Aides et des Comptes de Cahors y a été transférée, en dépit, il est vrai, d’une longue opposition de ses membres, vaine résistance face à la volonté supérieure d’amener à Montauban des élites sociales catholiques. Avec l’inflation du nombre de ses offices, cette cour est passée de vingt-sept charges lors de son transfert, à soixante-dix à la veille de la Révolution.
L’objectif des autorités consistait à reconquérir la population protestante. L’évêque et les deux chapitres de la ville étaient rentrés dès 1629, suivis par les Clarisses et les communautés anciennes de religieux mendiants. On s’installait tant bien que mal. Ainsi les Clarisses furent-elles contraintes de reconstruire leur maison et leur église, tandis que les Augustins logeaient chez des hôtes. Des communautés nouvelles, dans l’esprit de la Réforme catholique, ne tardèrent pas à s’implanter : les Capucins en tant que prédicateurs, les Jésuites pour former la jeunesse masculine dans l’ancien collège des protestants, les Carmélites, puis les Ursulines de Bordeaux, comme enseignantes des filles catholiques et des jeunes protestantes préparées à l’abjuration. À la génération suivante, les Lazaristes de Saint-Vincent-de-Paul prirent en main le séminaire. La scolarisation au sein de la population des faubourgs progressa pour les garçons au siècle suivant. En effet, l’évêque Michel de Verthamon fonda en 1744 dans le faubourg de Villenouvelle une école qu’il confia aux frères de la Doctrine Chrétienne, lesquels ouvrirent ensuite deux autres établissements.
La présence de l’Église catholique a été rendue plus visible encore par deux constructions majeures. Le nouveau palais épiscopal, devenu le musée Ingres-Bourdelle de nos jours, a été commencé dès 1664 par l’évêque Pierre de Bertier au bout du Pont Vieux sur le Tarn. La nouvelle cathédrale, après la révocation de l’édit de Nantes, a dressé lentement sa grande silhouette blanche de pierres taillées, exceptionnelle, au-dessus de la ville rose, sur le point le plus élevé de la ville. Sa construction, d’abord subventionnée par Louis XIV, fut mise en œuvre sur les plans de l’architecte du roi, François d’Orbay, et poursuivie par ses successeurs, Jules Hardouin-Mansart puis Robert de Cotte. Mais par la suite, faute de moyens financiers suffisants, les constructeurs furent contraints d’employer des matériaux de moindre qualité, ce qui nécessita des réparations précoces. Enfin, le 1er novembre 1739, la nouvelle cathédrale est consacrée sous le nom de Notre-Dame de l’Assomption.
Quand l’année 1789 approche, Montauban est également devenue une capitale culturelle. L’Académie des Belles Lettres est créée en 1730 par Le Franc de Pompignan qui introduit le violoniste Étienne MANGEAN dans la section musicale. Louis XV reconnaît cette société par les lettres patentes de 1744. De son côté, la ville a acheté la maison de l’ancien jeu de Paume et en a fait une salle de spectacles. La programmation laissa d’abord à désirer. Ainsi, d’après les Notices historiques (Forestié, 1882), la municipalité loue la salle, en janvier 1776, pour 150 livres, au musicien Martin BONNET, afin qu’il puisse y « donner des bals pendant le carnaval, jusqu’à ce qu’il se présente une troupe ». Aussitôt, de nombreux Montalbanais adhèrent au projet des futures réjouissances. Mais, bien qu’averti par le maire de la ville, le duc de Richelieu, gouverneur de la province, se permet d’accorder à la dame Delisle le privilège d’y donner des bals et de jouer la comédie, l’opéra bouffe ou autre, avec sa troupe. Le conflit qui en découle aussitôt ne s’apaise qu’avec le remboursement du musicien organisateur. Cependant, à partir de 1788, une meilleure organisation permet à des troupes d’artistes en tournée dans les villes du Sud-Ouest de donner à Montauban des spectacles de qualité.
Deux imprimeurs étaient brevetés au XVIIIe siècle. En 1764, le nouvel évêque, Mgr de Breteuil, s’empresse de restituer à l’imprimeur Fontenel le privilège retiré à Jérôme Legier, son prédécesseur, pour avoir fait des publications imprudentes. Il est en effet important, pour le jeune prélat, que les œuvres du fondateur de l’institut des Frères des Écoles chrétiennes, ainsi que les livres à l’usage des enfants des écoles, soient imprimés. Cette anecdote n’éclaire pas sur les lectures de la population instruite, mais elle témoigne d’une activité plus intense pour les imprimeurs et d’une alphabétisation en progrès. Quant à la pratique musicale, sans doute n’est-elle pas négligeable, puisqu’à la fête républicaine du 14 juillet 1794, les autorités peuvent réunir 20 tambours et 25 musiciens, ainsi que les meilleurs organistes et musiciens d’Église.
• • • Le chapitre et les musiciens de la cathédrale
Le 13 avril 1730, Michel de Verthamon de Chavagnac prenait possession de son évêché dans la cathédrale provisoire Saint-Jacques. Depuis 1629, à la suite de la disparition de l’ancienne cathédrale Saint-Théodard et de la collégiale Saint-Étienne-du-Tescou, les deux chapitres montalbanais avaient été contraints d’y célébrer ensemble le service divin. Les querelles de préséance n’avaient pas tardé à surgir. En 1667, afin de les réduire, Mgr Pierre de Bertier avait réuni les deux structures en un seul chapitre. Toutefois, chacune conservait sa mense : ainsi demeurait-on chanoine de Saint-Martin, nom du premier patron de la cathédrale, ou de Saint-Étienne. Chacune des deux menses contribuait, entre autres et à égalité, aux rémunérations des musiciens, à l’entretien des enfants de chœur et à celui de l’orgue. Le chapitre, dans son ensemble, était constitué de 24 chanoines portant l’aumusse grise, de 60 hebdomadiers, prébendiers et clercs portant l’aumusse rousse pour les premiers et noire pour les seconds, d’autres clercs et de deux bedeaux. Avec les musiciens et chantres, cela donnait un chœur de « cent surplis qui [faisaient] l’office avec la décence et la modestie prescrite par le cérémonial romain » (Lebret, 1668). Si le nouvel édifice est consacré le 1er novembre 1739, il n’est ouvert au culte qu’en 1741 et il semble bien que le déménagement des chanoines doive attendre cette même année 1741. Anne-François Le Tonnelier de Breteuil, le successeur de Mgr de Verthamon, mort en 1762 à l’âge de 75 ans, est parfois accusé de vivre en grand seigneur dépensier. Il est vrai qu’il disposait d’une fortune personnelle. Mais dans son diocèse, il semblait surtout préoccupé par la forte présence protestante et par le progrès des idées nouvelles. Aussi travailla-t-il à la formation de son clergé et à l’éducation religieuse des fidèles. Élu député aux États Généraux de 1789, il ne peut que demeurer fidèle à ses convictions conservatrices et, par conséquent, s’opposer à toute innovation. Après la dissolution de l’Assemblée constituante, il se réfugie à Rouen, y est arrêté et meurt en prison au mois d’octobre 1794.
Le grand orgue de 1675, que l’évêque Pierre de Bertier avait commandé pour la cathédrale provisoire de Saint-Jacques, avait été construit par le facteur anglais Jean Haon et par le sculpteur Jean Dussault pour le buffet en noyer. Comme il appartenait au chapitre, il fit partie du grand déménagement. Dès 1776, les chanoines le confient au facteur Jean Pierre CAVAILLÉ afin qu’il le restaure et l’augmente jusqu’à 28 jeux répartis sur trois claviers. Par la suite et jusqu’à la Révolution, il reçoit 120 livres par an pour son entretien. Après plusieurs restaurations, la dernière ayant eu lieu en 1996-1999, cet orgue demeure le grand orgue de tribune. En 1790, Pierre VIGOUROUX (1719-1792) en est l’organiste depuis plus de quarante ans. Né de parents métayers dans un petit village proche de Rodez, il est arrivé à Montauban dès l’âge de 21 ans. Déjà organiste du chapitre de la cathédrale au moment de son mariage en 1744, peut-être ne quitte-t-il son instrument qu’au début de l’année 1792, contraint et forcé parce que le lieu est fermé au culte. Il mourra quelques mois plus tard.
Tout au contraire, le maître de musique Louis AMIEL ne prend ses fonctions que le 1er septembre 1789, succédant à Étienne ROUX, mort à l’âge de 80 ans quelques jours plus tôt. En fait, AMIEL réintègre la maîtrise de son enfance dont il était sorti joueur de serpent. Surtout, il revient finir sa vie ici après une carrière dynamique, au cours de laquelle le musicien d’Église a débordé de créativité bien au-delà de sa spécialité de serpent. Le voilà maître de musique à Montauban avec des émoluments annuels de « de 2 400 livres pour lui et la nourriture des enfants de chœur ». Mais l’engagement d’AMIEL permet peut-être aux chanoines de moins recourir à des sous-maîtres des enfants de chœur. Dans les dernières années de la vie d’Étienne ROUX, ils étaient deux, CLAVEL et BRUNET, qui percevaient un salaire faible de la part du maître de musique, mais dont le chapitre complétait les moyens de vie par de fréquentes gratifications. Dans sa demande de pension de 1791, AMIEL explique qu’en revenant à la maîtrise de Montauban, il « croyait y trouver un asile et une retraite assurée », avec la promesse d’une « pension annuelle et viagère de 800 livres ». Mais de violents événements politiques éclatent à Montauban entre, d’une part, la bourgeoisie libérale que les premières élections ont portée au gouvernement de la ville et qui rassemble beaucoup d’entrepreneurs ou de chefs d’entreprises protestants, et d’autre part, un groupe important de nobles, majoritairement catholiques et hostiles aux premières décisions politiques. Les violences de la journée du 10 mai 1790, au cours de laquelle les opposants au nouveau régime assiègent la garde nationale montalbanaise, se soldent par des morts du côté des « patriotes ». Une période menaçante s’amorce en 1792. C’est alors que Louis AMIEL repart pour Toulouse, là où il a mené tant d’activités musicales pendant 35 années.
Et les enfants de chœur ? Dans la mesure où le chapitre acquitte des dépenses, notamment en 1786, « pour six paires de souliers à la maîtrise », « pour la façon de six aubes », le multiple six réitéré semble correspondre à l’effectif des enfants. Mais nous ne les connaissons pas, excepté DUCHATEAU, le « premier » d’entre eux, celui qui prépare sa sortie et à qui le chapitre alloue huit livres destinées à l’habiller et à le chausser de neuf, sans oublier les cols et les paires de bas. Nous ne connaissons pas plus les musiciens. Pourtant, les chanoines savent apprécier leurs qualités. Ainsi, le 2 mai 1786, ils décident spontanément de donner 24 livres à Michel CONCHE « pour avoir joué du serpent pendant les deux derniers jours, et en qualité de musicien étranger et voyageur ». Or, ce chantre et musicien avait déjà exercé brillamment son art dans de nombreuses villes du Sud-Ouest.
Tout en bas de l’échelle, on rencontre le souffleur d’orgues qui, en 1787, perçoit 15 livres d’appointements par trimestre, et Toussaint, le carillonneur de la cathédrale qui, en plus de cette même somme, se voit attribuer 24 livres pour « monter l’horloge » tout au long de l’année et 18 autres pour remboursement des frais du feu de la Saint-Jean.
• • • La principale église paroissiale : Saint-Jacques
Elle est la plus ancienne église de Montauban. Dans son Répertoire manuel qui était une sorte d’état de son diocèse, Mgr Le Tonnelier de Breteuil considérait Saint-Jacques comme la « première paroisse de la Ville et du diocèse ». (Daux, 1913). La cure est réunie à la sacristie de la cathédrale. Cette paroisse compte 18 000 communiants, car elle s’étend au-delà du quartier de la cathédrale, et l’évêque qualifie de « succursales de Saint-Jacques » plusieurs autres grandes paroisses de la ville. L’église a été également, rappelons-le, la seule à survivre aux guerres de Religion. Aussi y a-t-on chanté le Te Deum en août 1629 quand Richelieu est entré dans la ville et le cardinal lui-même y a célébré l’office le lendemain. Elle était si endommagée que les réparations ont duré jusque dans l’été 1631. Mais Saint-Jacques était alors capable de remplir décemment sa nouvelle fonction de cathédrale. Bâtie sur le plateau qui domine le Tarn et à proximité du nouveau palais épiscopal, elle a l’âge de la fondation de Montauban. Son clocher octogonal de style gothique toulousain s’élance haut dans le ciel et sert de guide aux touristes qui, au-delà du Pont-Vieux, cherchent le cœur de la ville historique. Sa grande nef unique sur croisée d’ogive atteste le caractère languedocien de l’édifice. Mais la façade au décor roman date du XIXe siècle.
Rappelons que le grand orgue a suivi les chanoines dans leur déménagement, dépouillant ainsi l’église de la plus vaste et de la plus notable des paroisses. On rachète donc un orgue d’occasion, mais une délibération du conseil de fabrique datée de 1843, c’est-à-dire au moment où il est devenu urgent de le remplacer, précise qu’à l’époque de son installation à Saint-Jacques il était déjà « vieux ». La paroisse la plus vaste et la plus importante de la ville ne pouvait pas perdre de son rayonnement. D’ailleurs, la plupart des musiciens et chantres de Montauban sont attachés à cette paroisse pour leur vie familiale.
En 1776, Jean FRESAL cède sa place d’organiste à Jean-Baptiste BONNET, un musicien âgé seulement de 20 ans, mais bientôt appelé ailleurs à un bel avenir de violoniste. FRESAL a déjà retrouvé son poste quand il se marie en 1784 et il touche toujours cet orgue en 1790. Il est plus difficile de retrouver les musiciens et les chantres attitrés de l’église Saint-Jacques. Il semble cependant jaillir de cette paroisse une certaine force qui ne se devine pas dans les autres lieux de musique. La famille Bonnet n’est pas étrangère à cette impression. En 1776, le registre de police note que Martin BONNET est « depuis longtemps utile [à Saint-Jacques] comme chantre et musicien ». En 1842, il est précisé sur l’acte de décès de son fils Jean-Baptiste : « fils de défunt Martin Bonet, maître-tailleur et le défunt professeur de musique ». Ne voit-on pas, ce même Martin BONNET, entouré par trois de ses grands enfants, intervenir, en 1787, dans une famille de négociants, afin de permettre le bon déroulement du baptême d’un nouveau-né dont le père et les parrain et marraine prévus sont absents ? D’autres musiciens vivent sur la paroisse Saint-Jacques sans être identifiés comme musiciens d’Église. Ainsi, Charles MATHIEU, fils d’un musicien engagé successivement à la cathédrale de Metz, à celle de Nantes et à la Sainte Chapelle de Dijon, est arrivé sur la paroisse Saint-Jacques en 1786 et on le voit participer aux activités musicales de la ville jusqu’à sa mort. Il est bien difficile d’admettre qu’il n’ait jamais exercé en église, que ce soit avant la suspension du culte catholique ou après son rétablissement, contrairement à son ami Jean-Baptiste BONNET, violoniste reconnu et organiste à la cathédrale de Montauban dès son retour en sa ville natale.
Il y a probablement à Montauban d’autres lieux de musique d’Église ou, du moins, de plain-chant. Nous pensons aux paroisses et aux huit communautés religieuses de femmes et d’hommes. Mais à ce jour, nous n’y avons retrouvé aucun nom de chantre ou d’organiste.
III – DANS LE BAS-QUERCY, SEULES DEUX COLLÉGIALES RÉSONNENT DE MUSIQUE
• • • Moissac, une ville du Quercy à la porte du Languedoc
Au début de la Révolution, Moissac est une ville moyenne de 10 000 habitants. De nos jours, elle est connue et admirée pour les chapiteaux historiés de son cloître et le tympan remarquable de son ancienne abbatiale, un chef d’œuvre de l’art roman inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. Saint-Pierre était en effet une très riche et très puissante abbaye bénédictine. Mais, si elle a su se relever à l’issue de la période difficile de la guerre de Cent Ans, son déclin s’est ensuite accéléré avec le déclenchement des conflits religieux. En 1626, elle était sécularisée : une communauté de chanoines se substituait aux moines bénédictins, formant ainsi « la collégiale de cette ville », comme on disait alors.
Sur le plan géographique, Moissac partage des points communs avec Montauban. Cette ville est arrosée par le Tarn et elle est proche des grandes plaines centrales, tout en appartenant à l’ancienne province du Quercy. Mais au XVIIIe siècle, le canal latéral de la Garonne, prolongement du Canal des Deux-Mers, n’est pas encore creusé. Les eaux du Tarn, grossies par son affluent le Lemboulas qui descend des collines du Quercy, longent la ville et s’en vont, à quelques kilomètres vers l’ouest, confluer avec celles de la Garonne. Ainsi, le port de Moissac est-il actif depuis le XVe siècle. Comme celui de Montauban, mais dans des proportions moindres, il assure en direction de Bordeaux une exportation lucrative de produits transformés et agricoles : vins et textiles bien entendu, et plus encore les farines de blé moulu dans le grand moulin de Moissac. Ce commerce est à son apogée au XVIIIe siècle, d’où la présence de beaux hôtels particuliers en ville.
D’abord bourg monastique, la ville s’est ensuite développée au pied de l’abbaye fondée sur les dernières pentes des collines, en épousant la déclivité du terrain. C’est alors une halte importante sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. La route qui descend depuis Lauzerte tourne vers l’ouest en suivant la Garonne jusqu’à Auvillar, puis continue vers Agen.
La plus importante des paroisses est alors Saint-Michel, sur laquelle se tient l’abbaye au ras des remparts de la ville. Elle dispose de sa propre église, ainsi que de plusieurs annexes. La configuration du lieu ainsi que les habitudes posent de réels problèmes. L’administration communale « n’a de cesse d’essayer de remédier à l’état de saleté des rues moissagaises, étroites, malodorantes, où chacun déversait ses boues et détritus, où divaguaient les volailles et cochons […]. Les rues étaient traversées par une rigole médiane, dans laquelle s’écoulaient les eaux sales et se déversaient dans les faubourgs… » (Fayolle-Bouillon, 2011). Il faut imaginer les eaux pluviales, parfois violentes et abondantes, qui s’écoulent mal, et leur stagnation qui va jusqu’à menacer des fondations des maisons. Ainsi, le mur de clôture de la propriété de l’organiste Charles THÉVENARD est-il l’un des nombreux obstacles à l’écoulement des eaux pluviales. À partir de 1745, les consuls tentent de résoudre ce point noir : ils font percer le mur, essaient en vain un aqueduc. La solution drastique qui consistait à utiliser le jardin pour y canaliser l’eau n'est appliquée qu’en 1786.
• Maîtrise et musiciens au service du chapitre
La vie du chapitre était régie par le procès-verbal de la fulmination de l’official de Cahors, en 1626, qui précise :
« Nous avons ordonné que les Chanoines créent quatre enfants de chœur pour le service de la musique, et un Préfet de chapelle ou Maître de chant expert dans l’art de la Musique, qui puisse enseigner son art auxdits enfants, un Organiste et un Bedeau qui seront mis et enlevés au frais du Chapitre, institution qui sera à leur charge et frais. » (Lemouzy, 1995).
En 1790, le maître de musique, Gaudens GARCEAU, dirige la maîtrise où se forment les quatre enfants de chœur. Comme c’est à lui de les entretenir, le chapitre lui remet chaque année, à la fois pour ses honoraires et pour le soin des enfants, 1 236 livres en argent, ainsi que du vin et du blé. GARCEAU est expérimenté. Quand il arrive avec femme et enfants au service du chapitre, il a longtemps travaillé à la cathédrale d’Auch où il s’est fait apprécier pour la qualité de ses « Noëls à grand chœur ». Qui a-t-il remplacé à Moissac ? La réponse est difficile car plusieurs maîtres de musique ont occupé brièvement cette charge dans la dernière décennie. Jean-Baptiste BRISSON échappe à ce schéma. Sans doute était-il en activité réduite, puisqu’il était déjà présent comme musicien en 1770 et qu’il figure ainsi dans l’inventaire de 1790 : « Le Sr BRISSON qui a été maître de musique, âgé de 80 ans. Les services luy ont valu un titre à vie de ses gages pour 360 livres ». Quatre musiciens sont également nommés dans ce document. Le serpent Jean OLIVIER, né dans une famille de tisserands moissagais, perçoit « à vie » 350 livres par an. Les gages des trois autres n’atteignent que 120 livres. Ce sont DUPUY, Jacques BOSQUE, qui pratique également le métier de tailleur d’habits, et RATIER, réduit à une pauvreté si extrême que le chapitre le secourt par une aumône en 1789. Sans doute les chanoines recourent-ils à des spécialités, selon les besoins. Ainsi, Gervais FAURÉ, fils d’un forgeron toulousain de Tournefeuille, qui s’éteint six mois avant la fermeture du chapitre, est qualifié de basse-taille en 1767, chantre sans autre précision l’année suivante, musicien dans la période 1772-1784, et de nouveau basse-taille sur le livre de comptes du chapitre de 1780. À ce moment-là, BOSQUE exerce comme basson. Michel Lemousy a relevé des rémunérations de « haulte contre » à la fin du siècle précédent, mais les informations à ce sujet font défaut pour la fin de l’Ancien Régime.
• Un orgue grandiose « offert par Monsieur le cardinal Mazarin » et ceux qui le servent
L’orgue était ancien. Un acte daté de 1543 certifie qu’un organiste était rémunéré, mais il ne renseigne pas sur l’ancienneté de son engagement par le chapitre et ne donne aucun indice sur l’âge de l’instrument. L’année 1665, elle, est celle d’un grand évènement : la construction d’un magnifique buffet. Le sculpteur montalbanais Jean Dussault en aurait été l’auteur, sur les plans de Jean Haon, le facteur que nous rencontrons quelques années plus tard à Montauban. Avec le positif ajouté au début du siècle suivant, cet orgue est considéré comme l’un des plus beaux du département. Aussi, quand la maison Aristide Cavaillé-Coll construira un nouvel instrument en 1862, conservera-t-on le buffet, la tribune et le positif. Ce buffet avait-il été « offert par Mazarin » qui fut l’abbé commendataire jusqu’à sa mort en 1661 ? En 1790, les officiers municipaux notent la présence d’un « orgue que les messieurs ont dit leur appartenir comme leur ayant été offert par Monsieur le cardinal Mazarin ». En fait, cette belle réalisation, d’ailleurs postérieure à 1661, dédommageait peut-être les chanoines de certains devoirs que leur célèbre (et trop lointain) abbé n’avait pas acquittés de son vivant.
Charles THÉVENARD, un vieux musicien né avec le siècle et mort en 1786, a marqué par la longévité de son service d’organiste commencé en 1741, et par sa personnalité qui l’a conduit, par exemple, à entrer au Conseil de ville et à présenter, sans succès, une œuvre de sa composition au concours du Concert Spirituel de Paris, en 1769. Il était arrivé de Bordeaux où sa famille appartenait au milieu musical qui gravitait autour de la cathédrale Saint-André. Avec son décès prend fin une longue période de stabilité à la collégiale de Moissac. En 1790, c’est le sieur DELORME qui touche l’orgue. Il n’a toutefois pris ses fonctions qu’en juillet 1789, succédant à Pierre GILODÈS, un jeune Aveyronnais engagé l’année précédente. De « Monsieur » DELORME, nous ne connaissons rien, si ce n’est qu’il reçoit 100 livres d’aide sur les frais de déménagement de ses meubles, et que ses émoluments annuels s’élèvent à 700 livres avec un titre « à vie ». Ce salaire lui permettra d’obtenir, après la suppression du chapitre, une pension de 300 livres. Peut-être continuera-t-il à vivre dans cette petite ville de Moissac, où il était encore en 1795.
Le chapitre et sa maîtrise semblent avoir été un lieu actif de musique d’Église. Et comme la grande paroisse Saint-Michel était, de fait, en lien avec la collégiale, activité de musicien et service de clerc tonsuré paroissial allaient souvent de pair. Mais il est arrivé à plusieurs reprises que nous perdions de vue certains de ces jeunes hommes au bout de quelques années de pratique. Étaient-ils appelés ailleurs pour mener une carrière de musicien ou bien pour se consacrer à la prêtrise ? C’est ainsi que le jeune prêtre Étienne DECOMPS, un Moissagais, clerc tonsuré puis vicaire de paroisse tout en exerçant comme musicien du chapitre, disparaît du registre paroissial en 1775. Il meurt à Saint-Rustice en 1783, une petite paroisse située à une douzaine de kilomètres au sud de Verdun-sur-Garonne, dont il était le curé depuis son départ de Moissac.
Montpezat-de-Quercy : l’ancienne collégiale Saint-Martin a été fondée en 1343, par le Montpezatais Pierre des Prés, cardinal à la cour d’Avignon. Un très riche mobilier y demeure, dont ces remarquables tapisseries flamandes tissées au XVIe s, illustrant la vie de Saint Martin de Tours. Elles viennent d’être restaurées. (cl. Office de Tourisme du Quercy Caussadais)
• • • Montpezat-de-Quercy se trouve au nord-est de Moissac, presqu’en limite du département du Lot. C’est une petite ville en lisière du Causse de Limogne, à très faible distance de la route de Paris qui descend vers Montauban et Toulouse. Montpezat se dresse au-dessus de la vallée profondément creusée par le Lemboulas, qui se jette dans le Tarn un peu en amont de Moissac. C’est un village médiéval typique, perché sur un sommet, fortifié et doté d’un château. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, il appartenait au diocèse de Cahors, mais relevait de la généralité de Montauban et de la subdélégation de Caussade. Sa notoriété touristique actuelle, Montpezat la doit sans nul doute à son site fortifié et au beau cloître construit par les Ursulines, mais plus encore à l’ancienne collégiale fondée au XIVe siècle par le cardinal Pierre des Prés, un proche collaborateur du pape. La collégiale Saint-Martin s’est attachée à la paroisse du même nom, son doyen devenant, par voie de conséquence, le curé de Montpezat. Puis elle a réuni plusieurs églises rurales, réduites, avec leur vicaire, à de simples succursales. En 1764, le subdélégué de Caussade répondait à une enquête de la généralité que le chapitre collégial de Montpezat comprenait un doyen, douze chanoines, un maître de musique qui avait droit au revenu d’un chanoine, ainsi que quatre semi-prébendés qui ne percevaient chacun qu’une moitié de ce revenu. Cette structure correspond à celle que nous trouvons au moment de la suppression du chapitre, le 2 novembre 1790.
Simon René BEAUCHEMIN, jeune clerc tonsuré diplômé de théologie, est engagé en 1775 comme maître de musique. Il vient de Saint-Brieuc [Côtes-d’Armor] et trois de ses frères sont eux-mêmes musiciens ou organistes dans les cathédrales de Bretagne. Il s’avance peu à peu vers le statut de chanoine. En effet, trois ans plus tard, il fait partie de l’assemblée d’ecclésiastiques et de notables qui, dans l’église des Ursulines, sont témoins de l’abjuration d’une « pensionnaire ». En 1784, devenu prêtre, il est témoin au baptême du fils du marquis de Lostange, gouverneur du Quercy, qui détient le titre de « fondateur » de la collégiale. Enfin, au début de l’année 1790, il signe « Beauchemin chanoine ». Or, à partir de 1788, Raymond RODOLOSSE, un clerc tonsuré né à Montpezat dans une famille de cordonniers, devient maître de musique avec un bénéfice qui lui assure un revenu annuel de 800 livres. Tout porte à croire qu’à cette date BEAUCHEMIN est déjà entré dans le corps des douze chanoines, ce qui a libéré la prébende de maître de musique, tout en lui laissant le titre de « directeur de la maîtrise ». Parmi les quatre semi-prébendés, aux côtés de deux clercs tonsurés et de Guillaume Gisbert qui a calligraphié les nouveaux livres choraux du diocèse, se trouve l’organiste. Il s’agit du Montpezatais Joseph BONNET qui a commencé, en 1773, à l’âge de 17 ans, sa carrière à la collégiale Saint-Martin. Il était alors l’un des deux clercs qui accompagnaient l’officiant lors des sépultures, lesquelles se déroulaient dans l’église de la paroisse Saint-Martin, c’est-à-dire à la collégiale. Dix ans se sont ainsi déroulés. En 1784, il est soudain devenu « clerc tonsuré prébendé » (il fait suivre sa signature de l’abréviation « prbd »), ce qui a mis fin à sa présence aux inhumations. Est-ce à dire que, bien qu’il ne soit pas devenu chanoine, il bénéficie désormais d’une prébende complète ? Toujours est-il qu’il est désigné comme « ancien prébendé » à son décès, en 1835.
Qu’est-il advenu pendant la Révolution ? L’église collégiale, de style gothique et en calcaire blanc, est devenue uniquement paroissiale et s’est enrichie d’une partie du mobilier de l’abbaye supprimée de Belleperche. Comme les autres chanoines, Simon René BEAUCHEMIN part en exil. Il rentrera au moment de la signature du Concordat et ouvrira par la suite une école élémentaire. Mais quand il s’éteint en 1810, son acte de décès se tait sur son activité de maître de musique, comme si elle avait été éphémère : le défunt était « prêtre et pensionné de l’État en qualité de chanoine ». Raymond RODOLOSSE se contente peut-être de la situation de « propriétaire ». D’ailleurs, Firmin Galabert a exprimé un doute sur ses capacités à tenir l’école communale sous le Directoire. L’organiste Joseph BONNET s’engage dans l’armée et fera la campagne d’Égypte. Quant à l’orgue, il n’a pas survécu : « Les tuyaux en étain furent vendus à vil prix » (F. Galabert, 1918).
Deux communautés religieuses s’étaient implantées à Montpezat au XVIIe siècle, à la fin des guerres de Religion. Les Ursulines demeuraient nombreuses au siècle suivant : trente religieuses de chœur, huit sœurs converses et une tourière en 1764. Elles participaient à la reconquête catholique, tenant l’école des filles en plus de leur pensionnat et préparant, comme nous l’avons constaté, des protestantes à l’abjuration. Mais disposaient-elles d’un orgue ? Chez les Récollets, arrivés comme missionnaires quelques années avant la révocation de l’édit de Nantes, nous n’avons trouvé aucune information sur l’organisation des cérémonies au chœur.
• • • Lauzerte est une petite ville tout-à-fait pittoresque du nord-ouest du Tarn-et-Garonne. Du haut de son promontoire, cette bastide fortifiée veillait sur la route qui conduisait de Cahors à Moissac. L’église Saint-Barthélemy et son clocher à base carrée signalent toujours la ville haute, tandis que les faubourgs constituent la ville basse. La période des guerres de Religion a laissé des souvenirs de violences et d’un grand massacre. Cependant, Lauzerte est demeurée catholique. La Révolution la promeut au rang de chef-lieu de district, mais la création du département la rétrogradera à celui de chef-lieu de canton. De nos jours, elle a gagné sa place parmi « les plus beaux villages de France ».
Deux frères, fils d’un boucher de la ville, appelés à une belle carrière, furent baptisés à l’église Saint-Barthélemy, Jean-Baptiste REY en 1734 et Joseph en 1737. Tous deux sont devenus très tôt de brillants musiciens. Recommandés par l’archiprêtre de Lauzerte, ils ont d’abord suivi à Toulouse le cursus habituel des musiciens d’Église. Puis ils se sont éloignés. Joseph REY, le violoncelliste, a exercé son métier à Versailles, dans la musique du roi, pendant les vingt dernières années de l’Ancien Régime, puis à l’Opéra de Paris. Jean-Baptiste a lui aussi pratiqué son art dans les plus prestigieuses institutions du royaume, là où se crée et s’exécute la musique d’Église et surtout de concert. Après Nantes, il reçoit la consécration à Versailles, puis à Paris où il deviendra chef d’orchestre de la chapelle de l’Empereur. Un troisième enfant de Lauzerte, François CARRETIER, fils d’un tailleur d’habits, est né aux environs de 1763. En 1786, il est sous-maître de musique à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, ville qu’il ne quittera plus.
Mais des musiciens d’Église ou des chantres, nous n’en retrouvons aucun qui exerce à Lauzerte en 1790 ou dans les années antérieures, pas plus d’ailleurs que dans les autres petites villes du nord du Tarn-et-Garonne. Montpezat apparaît bien comme une exception. Pourtant, des paroissiens ont participé à l’animation des moments religieux : ce sont les carillonneurs. À Lauzerte, quatre générations de la famille Lacoste ont assuré le service ininterrompu des cloches depuis la première moitié du XVIIIe siècle jusqu’à la décennie 1850, de père en fils. Le troisième d’entre eux est Charles LACOSTE. Baptisé en 1751, il est en activité au début de la Révolution puis laisse bien plus tard la place à son fils Vincent, lequel ne s’éteint qu’en 1859, qualifié de carillonneur.
IV – DANS LA VALLÉE DE LA GARONNE ET SES AFFLUENTS DE LA RIVE GAUCHE : QUELQUES ORGUES D’ABBAYES ET DE RARES PAROISSES MUSICALES
À l’intérieur de ce grand espace qui constitue presque essentiellement le nord-ouest du Languedoc, nous avons rencontré six lieux de musique dans un triangle de vingt à trente kilomètres de côté, dont les trois sommets sont Castelsarrasin, la pointe la plus septentrionale du Languedoc, Verdun-sur-Garonne, la première ville arrosée par la Garonne après son entrée dans le département, et Beaumont-de-Lomagne, traversée par la Gimone, un affluent de la Garonne qui remonte vers le nord confluer en amont de Castelsarrasin.
• • • Castelsarrasin, qui compte 7 000 habitants en 1793, se trouve au centre du département, à 8 km seulement de Moissac. Cette ville s’est développée sur la rive droite du fleuve. Dans cette zone alluviale, la ville médiévale, avec son château et ses murs de fortification, « a pris naissance sur un point un peu plus élevé et donc à l’abri des crues ». Cela signifie que toute la partie occidentale est inondable. Dans les registres de délibérations municipales, on relève une quarantaine d’inondations dont certaines ont laissé des souvenirs cauchemardesques, comme celle du 1er janvier 1768 où le gel brutal des eaux d’inondation empêchait de secourir les victimes (Boutonnet, 1982). Tout au contraire, l’est et le centre historique, où se trouve l’église Saint-Sauveur, sont à des altitudes qui les mettent à l’abri de la submersion. La route Toulouse-Moissac, construite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, traverse cette ville, et en 1775, on établit une belle promenade qui agrémente le grand espace libéré par l’achèvement de la démolition du vieux château. En revanche, contrairement à Moissac et surtout à Montauban, Castelsarrasin conserve une économie fondée sur la recherche de l’autosuffisance, et non sur l’exportation massive de céréales et de farines.
En 1789, s’élèvent quatre églises paroissiales : Saint-Sauveur dont les chapelles accueillent des confréries actives, Saint-Jean que les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem avaient érigée, Saint-Martin et Gandelou. Quatre communautés religieuses se sont installées en ville, les Carmes au XIIIe siècle et les trois autres au XVIIe : les Dominicaines et les Capucins dès 1602, les Ursulines en 1642. Les prêtres de l’église paroissiale Saint-Sauveur, qui possèdent un orgue, sont réunis dans la consorce du Purgatoire, une sorte d’association dont l’objectif consistait à assurer les obits de la paroisse, à gérer les revenus et legs qui en découlaient, mais aussi, à éduquer les enfants dans l’esprit de la Réforme catholique. Ainsi, en 1760, le syndic de la consorce précise que « tous les revenus sont des obits et des fondations », et que « cette consorce est composée actuellement de 19 prêtres et tous les enfants nés et venus dans l’Église de St-Sauveur ». C’est une église considérable qui n’a pas subi de destructions pendant les guerres de Religion, celle qu’on surnomme parfois « Castelsarrasin la catholique » n’ayant jamais été protestante. Reconstruite au XIIIe siècle et agrandie plus tard de chapelles, Saint-Sauveur était demeurée un brillant prieuré conventuel de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac jusqu’en 1626. En 1789, cette église gothique, avec ses trois nefs et son magnifique clocher octogonal à deux étages et à 32 fenêtres géminées, passe pour une des plus importantes du diocèse. Son intérieur sera ensuite embelli par l’acquisition, en 1799, d’une partie du mobilier baroque de l’abbatiale de Belleperche. Citons, entre autres, trente-neuf stalles remarquables, ainsi que les exceptionnelles boiseries sculptées du buffet d’orgue parfaitement intégrées dans celui de Saint-Sauveur, qui est classé monument historique depuis 1912.
Castelsarrasin : l’orgue de l’église paroissiale Saint-Sauveur. Les somptueuses sculptures baroques de son buffet proviennent de l’orgue de l’abbaye de Belleperche. L’église respire les boiseries de Belleperche travaillées des XVIIe et XVIIIe siècles : stalles, chaire, porte de la sacristie ... (cl. Mairie de Castelsarrasin)
Un premier orgue avait été offert par la confrérie des notaires, en 1320. Usé et fragilisé, il s’effondre en 1776 (Boutonnet, 1986). Les consuls passent commande d’un instrument neuf qui, d’après leur registre des délibérations, est enfin disponible pour Pâques 1785. Qui étaient les organistes ? En 1726, le trésorier de la consorce nommait, pour une somme modique, Pierre DUVILA, quinquagénaire ayant succédé à son père aux claviers. Il s’éteint en 1738, sans qu’aucun de ses fils n’assure la relève. Pour connaître ses successeurs, il faut parcourir les comptes de la confrérie du Saint-Sacrement. Au cours des dernières années du registre, les organistes n’assurent plus que des séjours courts. Sept sont successivement rémunérés entre le 13 mai 1788 et le 31 juillet 1793. Ne serait-ce pas dû à la modicité des rémunérations ? Par exemple, en 1788, un certain VALENTIN perçoit neuf livres « pour le temps qu’il a touché l’orgue » et JOLY, quarante pour un trimestre complet. CORBEGE dispose, lui, d’un statut qui est qualifié « d’organiste à compte d’honoraires ». On lui remet six livres le 11 septembre 1791 et douze, quatre jours plus tard. Puis, au mois de janvier suivant, on acquitte pour lui des dépenses de bouche à l’auberge, ainsi que le loyer de sa chambre, et on lui remet 70 livres pour les deux derniers mois pendant lesquels il a touché l’orgue. Tout au contraire, CARPENTIER, qui lui succède, est rémunéré en argent, mais seulement 55 livres par quartier, ce qui conduit le district à verser « un complément afin d’atteindre cent livres ». Qui sont ces musiciens qui n’ont parfois fait que passer ? Nous l’ignorons. De toute façon, les comptes de la confrérie ne livrent aucun indice, pas même les prénoms.
Jacques DANTIN est l’organiste des années suivantes, sans doute dès 1793 et jusqu’en 1797. Le profil de ce musicien surprend. Jeune, il était un Toulousain de la périphérie rurale. Il semblait assez instruit et vivait de son métier, d’abord de maçon, puis de charpentier. Autour de 1793, il part, accompagné de sa petite famille, empruntant vraisemblablement la nouvelle route Toulouse-Moissac qu’il a vu construire, et il s’arrête à Castelsarrasin. Dès le mois d’août, il est payé pour avoir nettoyé l’orgue de Saint-Sauveur et, en février 1794, alors que l’église est transformée en temple de la Raison, il perçoit 100 livres pour un trimestre de service en tant qu’organiste. Durant une « assemblée extraordinaire » d’octobre 1794, « les airs civiques et les chants patriotiques résonnaient peut-être plus allègrement que la musique religieuse qu’il interprétait naguère » (Boutonnet, 1989). Mais en 1798, lors de la déclaration de naissance d’un fils, DANTIN est redevenu charpentier, métier qu’il pratiquera jusqu’à son décès, en 1809.
Cordes-Tolosannes : l'ancienne abbaye cistercienne de Belleperche (1143-1790). Ses bâtiments ont été brillamment reconstruits au XVIIIe siècle, puis livrés à d'autres activités destructrices à la suite de la Révolution. Mais son beau mobilier cultuel qui fut alors dispersé en divers lieux est arrivé jusqu'à nous, en particulier dans l'église Saint-Sauveur de Castelsarrasin. Restaurée par le Conseil Départemental, Belleperche abrite maintenant le musée des Arts de la Table. (cl. Bertrand Bouret dit Profburp — Travail personnel, CC BY-SA 3.0)
• • • L’abbaye de Belleperche faisait face à la Garonne depuis le XIIe siècle. Cette fille de Cîteaux occupait un grand enclos à 6 km au sud de Castelsarrasin et tout près du village de Cordes (Cordes-Tolosannes). La mésentente multiséculaire entre sa seigneurie et les consuls de Cordes s’est perpétuée jusqu’à la Révolution, autrement dit jusqu’à ce que les biens de l’abbaye soient absorbés par Castelsarrasin.
Dans la liste du mobilier abbatial qui fut vendu tardivement aux enchères, seulement en 1799, figuraient deux des lots acquis par Castelsarrasin : « la cage où était l’orgue dont les tuyaux et garnitures avaient été enlevés » et « la tribune avec l’escalier en boiserie » (Boutonnet, 1986). Ces boiseries du XVIIIe siècle sont aujourd’hui intégrées dans le buffet de l’église Saint-Sauveur. L’instrument lui-même avait alors disparu depuis longtemps, peut-être en 1793. Les moines de Belleperche possédaient donc un orgue, mais nous n’avons pas retrouvé le dernier musicien qui le touchait. Peut-être s’agissait-il de l’un des religieux.
• • • L’abbaye Saint-Pierre de Mas-Grenier était, à une vingtaine de kilomètres au sud de Castelsarrasin, une maison de Bénédictins. Fondée très tôt au lieu-dit Mas-Grenier, sans doute avant l’an mil, elle avait donné son nom à la paroisse qui se développait à proximité. L’abbaye s’élevait sur le bord de la Garonne que l’on pouvait voir, dit-on, depuis certains bâtiments. La proximité du fleuve permettait aux moines d’entretenir un port et de commercer directement. Ainsi vendaient-ils eux-mêmes leur vin à Bordeaux. Aussi, les consuls de Mas-Grenier déclaraient-ils en 1701 que le port de Mas et le passage sur la Garonne avaient toujours appartenu aux moines depuis les siècles les plus reculés. La période des guerres de Religion fut un désastre pour l’abbaye et ses habitants. La paroisse de Mas-Grenier était devenue un village protestant (Martinazzo, 2012) dès la décennie 1560 et une place de sûreté en 1576. C’était, par conséquent, un centre de ralliement pour les protestants des villes demeurées catholiques, comme Verdun-sur-Garonne. L’abbaye fut envahie, pillée et, par la suite, brûlée. En 1574, les moines durent fuir et se réfugier à Verdun-sur-Garonne qui n’est distante que de 6 km. La soumission de Mas-Grenier ne se fit qu’en 1621, lorsque l’armée royale se présenta. Les Bénédictins réinvestirent les lieux processionnellement. Quelques années plus tard, l’abbaye entra dans la congrégation de Saint-Maur. La durée des réparations de ses bâtiments fut telle que la communauté n’entama la reconstruction de son église qu’en 1692.
Jean RODOLOSSE en est l’organiste en 1790. Engagé sept ans plus tôt, il venait du diocèse de Cahors, où il avait été enfant de chœur à la maîtrise de la cathédrale. Il est toutefois originaire de Montpezat-de-Quercy où son frère Raymond est au service de la collégiale Saint-Martin. C’est donc dans le diocèse de Toulouse, à 65 km de sa famille, que le jeune organiste exerce ses talents. Les moines lui attribuent 600 livres d’honoraires annuels, un salaire assez confortable. Il obtient la permission de s’absenter. Aussi est-ce lui qui, en avril 1785, présente sa nièce au baptême dans l’église Saint-Jacques de Montauban. En 1793, Jean RODOLOSSE a rejoint sa famille à Montpezat, alors dans le département du Lot, où il exerce comme maître d’école et « artiste musicien ». À son décès, il est qualifié « d’ancien instituteur ».
• • • L’abbaye de Grandselve, fidèle à la tradition cistercienne, vivait isolée au creux d’un vallon bordant la Nadesse, un petit affluent de la Garonne, sur la commune actuelle de Bouillac. Fondée au XIIe siècle, elle avait grandi rapidement, fondé à son tour, créé des bourgs et même de futures villes, comme Grenade-sur-Garonne et Beaumont-sur-Lomagne. Son influence religieuse et économique était à l’apogée dès le XIIIe siècle, c’est-à-dire avant la guerre de Cent Ans. Ses murs délimitaient un vaste enclos de 8 hectares et la très riche église construite au bas du coteau mesurait 100 mètres de long sur 20 de large, la population monastique atteignant plusieurs centaines de moines au Moyen Âge, un millier dit-on parfois. En 1789, la communauté est tombée à 16 religieux. Des bâtiments en partie reconstruits aux XVIIe et XVIIIe siècles, il ne subsiste, de nos jours, que la porterie.
D’après le mobilier inventorié en 1790, se trouvent « de très belles orgues avec leur positif, avec six soufflants » au fond de l’église (F. Galabert, 1900). Arnaud Ambroise BAROU est organiste depuis 44 ans. Jeune musicien dont les parents étaient marchands-droguistes dans la ville de Villefranche-de-Lauragais, il était venu prendre possession de cet instrument en 1746. Vingt-deux ans plus tard, ses employeurs lui expriment leur satisfaction par un contrat à vie dont il décrit les conditions dans sa demande de pension de 1791 : le salaire annuel est limité à 240 livres, mais il est nourri, logé à l’abbaye, entretenu de tout, traité comme « un religieux profès » si « le grand âge ou la maladie mettent un terme à son métier d’organiste », pourvu qu’il habite à l’abbaye jusqu’à la fin de ses jours et qu’il demeure « un homme d’honneur ». En 1778, BAROU se marie à Comberouger, un village distant de trois kilomètres. Nous ignorons ce qu’il advient alors du contrat de 1768, mais l’organiste demeure auprès de la communauté jusqu’à ce qu’elle soit contrainte de se disperser, puisqu’il a, par la suite, sollicité et obtenu une pension trimestrielle de 100 livres.
• • • Verdun-sur-Garonne avait environ 4 000 habitants au début de la Révolution. Cette ville n’est qu’à une dizaine de kilomètres de la limite avec la Haute-Garonne. Au XIIe siècle, elle vivait déjà du fleuve. Elle s’était équipée d’installations portuaires qui la plaçaient au premier rang entre Toulouse et Agen. Cette activité s’est poursuivie tout au long de l’Ancien Régime. Les guerres de Religion l’ont peu frappée et elle a toujours réussi à échapper aux sièges destructeurs. Aussi est-ce en ce lieu que les moines de Mas-Grenier avaient trouvé refuge, célébrant leurs offices à l’église Saint-Michel, une belle église qu’ils avaient eux-mêmes construite en 1216, classée monument historique depuis 1910. Certes, on avait dû la reconstruire au milieu du XVIe siècle, mais à l’identique, avec ses deux nefs et ses deux chœurs.
Verdun-sur-Garonne : l’orgue de l’église paroissiale Saint-Michel, reconstruit et enrichi par le facteur Lépine en 1768, en même temps que son buffet sculpté était agrandi. La restauration de la fin du XXe s lui a rendu « l’extrême qualité de ses timbres d’origine ». (cl. J.-G. Marquer, Orgues en France et dans le monde)
En 1768, la restauration de son orgue est confiée au facteur toulousain Jean-François LÉPINE qui, sur les conseils du mauriste dom BEDOS DE CELLES, « ajouta un clavier Positif intérieur, un clavier d’écho et un pédalier portant à 18 jeux », tandis que le buffet était agrandi et décoré. Des campagnes importantes se sont succédé aux cours des deux siècles suivants. Celle de la décennie 1980, réalisée par le facteur Alain LECLÈRE, a permis de remettre l’instrument dans sa disposition de 1768, ce qui permet d’apprécier à la perfection ses qualités de timbre. Jean-Baptiste SAMATAN a sans doute été le premier organiste à jouer sur l’orgue de Jean-François LÉPINE puisqu’il fut engagé aux environs de 1768. Ce jeune musicien était né à quelques kilomètres seulement de l’abbaye de Bonnefont, dans la montagne pyrénéenne, et nous ne connaissons rien de ses apprentissages. Arrivé à l’âge de 26 ans dans la paroisse Saint-Michel de Verdun, il s’y marie deux ans plus tard et ne la quitte plus. Ses émoluments sont acquittés par la fabrique, mais la suppression du culte catholique et l’organisation du culte de l’Être suprême le privent de son salaire. Alors, le 29 mai 1794, il sollicite des autorités du district la permission de jouer de l’orgue aux fêtes décadaires, contre une rémunération annuelle de 600 francs. Il est alors soutenu par les deux structures majeures de la ville, la Société populaire et le Conseil général. Les responsables du district ont-ils donné une suite favorable à cette requête ? SAMATAN a-t-il repris son service lors du rétablissement du culte catholique ? Cette seconde hypothèse est vraisemblable puisque l’officier d’état civil le qualifie d’organiste sur son acte de décès, en 1818.
Sérignac : Saint-Gervais-et-Saint-Protais, église paroissiale d’un village de Lomagne. Au XVIIIe s., cette modeste église avait les moyens d’entretenir deux prêtres chantres pour animer ses services religieux. (cl. Bastien.pierre — Travail personnel, CC BY-SA 4.0)
• • • Sérignac est un village agricole distant de 25 km à l’ouest de Verdun-sur-Garonne, à proximité de la vallée de la Gimone qui vient de traverser le bourg important de Beaumont-de-Lomagne. Ce qui surprend, c’est qu’une église paroissiale rurale puisse disposer de deux chantres. Le curé Lavaur explique, en novembre 1790, que le village de « Sérignac [peut] se flatter, avec ses œuvres et ses confréries, de posséder dans son église Saint-Gervais et Saint-Protais avec ses quatre prêtres : le curé, le vicaire et deux chantres, les plus belles cérémonies de toute la région ». Quel est donc le secret de cette aisance ? À la fin du siècle précédent, le curé Dumasbon a créé par testament une œuvre de charité qui s’appuyait sur ses biens et destinée à doter les filles pauvres à marier de Sérignac. Les consuls et les curés successifs devaient gérer cette œuvre et fournir les dots. Les revenus de la fondation ont fructifié avec la montée des prix agricoles, et plus encore après que le Parlement de Toulouse eut, en 1776, « reconnu la capacité civile du bureau des pauvres » dans lequel on avait inséré l’œuvre Dumasbon (de Bernard, 1966). Les successeurs de Dumasbon (son neveu en premier lieu) ont perpétué cette tradition de dons généreux pour l’entretien de l’église et la beauté du culte. Ainsi peut-on suivre, tout au long du XVIIIe siècle, les noms des chantres qui ont contribué à la beauté des offices. Il s’agit tout d’abord de Jean SOUBIRAN puis de Jean MOUYANCE, tous deux qualifiés de « prêtre, vicaire et chantre ». A partir de la décennie 1770, un duo assure ce service : « Les sieurs abbés DORSET et BEQUIÉ chantres de l’église de Sérignac ».
Le 13 décembre 1789, Durand LESPINASSE, âgé de 25 ans et originaire de la ville de Moissac, prend ses fonctions de chantre, rejoignant ainsi Bernard DORSET. Le curé Laborde, après avoir prêté le serment le 6 mars1791, abdique à la fin de l’année 1793, mais cela ne l’empêche pas de poursuivre les célébrations de la messe « avec une pompe insolite », sans même craindre une arrestation en représailles. Les deux chantres, privés d’emploi, sollicitent une pension. DORSET, en vertu de la longévité de ses services et de son âge avancé, obtient 400 livres par an. Et le jeune LESPINASSE ? Le directoire du district de Grenade-sur-Garonne, dont fait alors partie le canton de Beaumont-sur-Lomagne, décide de ne pas faire de différence et propose, en juillet 1791, une somme égale au profit du dernier arrivé. C’est alors que nous perdons de vue les deux chantres. Quand ont-ils quitté Sérignac ? Ont-ils participé, à un moment donné, à ces messes devenues illégales parce qu’au culte catholique avait succédé celui de la Raison ? Nous savons seulement qu’en 1797, quand Anne Nègre, la mère de Durand Lespinasse, est inhumée à Moissac, son acte de décès désigne Barthélémy comme « fils cadet » alors qu’il est le dernier né de ses trois fils et que son frère Durand Louis Martial vit encore. L’aîné des garçons, le chantre Durand, était peut-être déjà mort en novembre 1797.
• • • Auvillar qui est située à l’extrémité occidentale du département est une terre gasconne. Cette petite ville active de 2 000 habitants en 1793 s’est développée sur un éperon rocheux qui domine la Garonne et la plaine. Tout au long des siècles, elle s’est trouvée sur le passage des armées. Sur l’autre rive du fleuve, commence l’Agenais avec le village d’Espalais qu’un pont réunit, de nos jours, au bourg d’Auvillar.
En 1785, un Lorrain nommé Jean-Blaise LAURENT se marie à l’église Saint-Pierre d’Auvillar avec une veuve d’Espalais. Né à Bruyères dans les collines des Vosges, entre Épinal et Saint-Dié, il y était devenu le chantre de son église paroissiale et le régent de l’école. Mais il disparaît soudain du registre paroissial dans la décennie 1770, après son veuvage. En 1785, nous le retrouvons donc à 800 km, dans les plaines du sud-ouest du royaume. Il exerce alors la fonction de contrôleur des Fermes d’Auvillar, sans aucune allusion à un éventuel service de chantre. Six ans plus tard, commence son ascension sociale dans le pays d’accueil : juge de paix du canton d’Auvillar dès 1791, député à la Convention en septembre 1792, maire d’Auvillar et administrateur du canton à la fin de sa vie. Il meurt à Espalais en 1799, il est inhumé à Auvillar, et l’officier qui rédige son acte de décès barre « fils de », comme si la première partie de sa vie était à tout jamais effacée des mémoires.
Nous n’avons retrouvé aucun musicien ou chantre d’Église engagé à Auvillar, bien que l’église paroissiale Saint-Pierre soit une des plus remarquables du diocèse et que les activités économiques de cette ville portuaire aient accédé à un bon niveau. En revanche, pendant toutes ces années, Jean LASSERRE est « sonneur des cloches » à Saint-Pierre d’Auvillar. Après quatre décennies de participation aux cérémonies mortuaires catholiques de sa paroisse, ce brassier devenu laboureur s’éteint en 1810, âgé de 76 ans. Sonneur des cloches ? Ce terme est rarement rencontré dans les registres paroissiaux du XVIIIe siècle, au bénéfice de carillonneur, vocabulaire qui se perpétuera au XIXe. D’ailleurs, en 1760, quand le vicaire baptise la fille aînée de LASSERE, il qualifie ce dernier de carillonneur et non de sonneur des cloches, ce qui demeure exceptionnel à Auvillar.
• • •
L’effectif des musiciens d’Église qui exerçaient en 1790 sur le territoire du futur département du Tarn-et-Garonne et qui ont été retrouvés, ne s’élève qu’à dix-neuf individus : huit organistes, quatre maîtres de musique, sept chantres et musiciens.
| Lieux de musique et effectif connu | Organistes | Maîtres de musique | Musiciens et chantres |
|
• cathédrale de Montauban Chapitres : 11 |
1 1 1 |
1 1 1 |
0 5 0 |
|
• Granselve (à Bouillac) Abbayes : 2 |
1 1 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|
• St-Jacques (Montauban) Paroisses : 6 |
1 1 1 0 |
1 0 0 0 |
0 0 0 2 |
Ces résultats sont sans doute inférieurs à la situation réelle, en particulier pour les chantres et musiciens. Néanmoins, il apparaît que leur répartition géographique est inégale. Au centre, Montauban et la collégiale de Moissac présentent les meilleurs chiffres, bien que la performance de la ville épiscopale, si peuplée et si développée, soit modérée. Au nord, la collégiale de Montpezat est une exception dans un Bas-Quercy presque vide d’activités musicales d’Église. En revanche, la rive gauche de la vallée de la Garonne et de ses affluents, qui appartient au Languedoc, rassemble six lieux de musique.
La ville de Montauban, un des bastions protestants à l’échelle du royaume pendant toute la durée des guerres de Religion, a nourri la présence protestante dans le nord du futur département. En dépit de sa brutalité, la reconquête militaire catholique a été longue. Dans la ville même de Montauban, le dernier évêque s’inquiétait encore de la forte proportion protestante, en particulier au sein de la bourgeoisie et des acteurs de la vie économique. Tout au contraire, les autres villes de la rive gauche de la Garonne, ainsi que Moissac, ont été moins durement victimes des affrontements religieux et militaires. D’ailleurs, malgré un environnement protestant et des monastères isolés particulièrement meurtris, beaucoup d’entre elles étaient demeurées catholiques, ce qui leur avait évité une reprise en main militaire finale. Toulouse, moderne et riche, était une capitale catholique influente. Cette attractivité perdura puisque des communes concernées en 1808 par leur rattachement au nouveau département du Tarn-et-Garonne, ont exprimé leur désaccord.
Les églises dotées d’une consorce de prêtres ne recouraient pas au service de musiciens ou de chantres. La communauté se suffisait à elle-même, excepté peut-être pour la spécialité de l’orgue. Or, ces associations ecclésiastiques se rencontraient parfois dans des agglomérations aisées qui auraient sans doute eu les moyens d’entretenir plusieurs musiciens et chantres, telles les villes de Castelsarrasin, Verdun-sur-Garonne ou Beaumont-de-Lomagne. En revanche, la présence de carillonneurs d’église jusque dans les petites paroisses est remarquable, aussi bien sur les terres du Quercy montalbanais que sur celles du Languedoc toulousain. Les cloches sonnaient pour annoncer, célébrer, accompagner, comme à Albias, un bourg protestant sur la route de Caussade qui fut très endommagé en 1621, où le serger Jean POUZARGUE, carillonneur en 1758, le demeura bien au-delà de la Révolution, ou bien comme à Puygaillard-de-Lomagne, ce petit village toujours catholique du sud-ouest où vivait Raymond BAYROU, potier de terre et carillonneur âgé de 33 ans en 1790. Sur l’ensemble du futur département, y compris sur de grands territoires apparemment dépourvus d’animation musicale religieuse, des carillonneurs parfois modestes étaient bien souvent à l’œuvre.
Dans la décennie qui précède 1790, les instruments de musique, quand ils sont signalés, se limitent le plus souvent au serpent. Des violonistes sont cependant évoqués, mais il s’agit de musiciens venus d’ailleurs, ou formés par les chapitres et partis faire carrière ailleurs. La rémunération annuelle la plus importante atteint 800 livres pour le maître de musique du chapitre de Montpezat, mais les salaires oscillent généralement entre 300 et 400 livres. Des gratifications substantielles, pratique très utilisée par les chanoines de la cathédrale, ou parfois des avantages en nature, comme le gîte et le couvert, complètent des émoluments trimestriels relativement modiques. Finalement, huit musiciens au moins, quelle que soit leur spécialité au bas chœur, présents en 1790 ou décédés à un âge très avancé à partir de 1786, ont servi en un même lieu et sur une durée de 20 à 45 années, même quand ils étaient originaires d’autres diocèses. Sans doute reste-t-il d’autres musiciens d’Église à retrouver dans le Tarn-et-Garonne, ou à mieux connaître.
Renée BONS-COUTANT
Docteur en Histoire
(mai 2022)
Le travail sur les musiciens de ce département a bénéficié des apports de nombreux contributeurs, notamment de François Caillou, Youri Carbonnier, Bernard Dompnier, Sylvie Granger, Béatrice Guy, Isabelle Langlois, Christophe Maillard, Françoise Talvard, Michelle Coupry, Sylvie Vialatte ...
Mise en page et en ligne : Caroline Toublanc (CMBV)
>>> Si vous disposez de documents ou d’informations permettant de compléter la connaissance des musiciens anciens de ce département, vous pouvez signaler tout élément intéressant ICI. Nous vous en remercions à l’avance.
L’amélioration permanente de cette base de données bénéficiera à tous.
Les lieux de musique en 1790 dans le Tarn-et-Garonne
Les lieux de musique documentés pour 1790 dans le département sont présentés par diocèse et par catégories d’établissements : cathédrales, collégiales, abbayes, monastères et couvents, autres établissements (par exemple d’enseignement, de charité…) et paroisses (ces dernières selon l’ordre alphabétique de la localité au sein du diocèse).
Diocèse de Montauban
- Cathédrale
- Abbaye
- Églises paroissiales
Diocèse de Toulouse
- Abbayes
- Église paroissiale
Diocèse de Cahors
Pour en savoir plus : indications bibliographiques
SOURCES IMPRIMÉES
- Henry LEBRET (prévôt de l’église cathédrale de Montauban), Histoire de Montauban, Montauban, Samuel Dubois, 1668, 261-382 p.
- Jean-Joseph EXPILLY, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Paris, Desaint et Saillant, 1762-1770, 6 vol.
- Antoine-Augustin BRUZEN DE LA MARTINIÈRE, Grand Dictionnaire géographique historique et critique, tome premier, Paris, Le Mercier & Boudet, 1739.
- CAMINEL, 1er échevin de la ville, Relation du débordement de la Rivière Tarn survenu le 14 novembre 1766, et des effets qu’il a produits dans la ville de Montauban, Montauban, permis d’imprimer 26 novembre 1766 [Transcription par J.-C. Toureille].
- Arthur YOUNG, Voyages en France (1787-1789), traduction par Henri Sée, Paris, A. Colin, 1931.
- Recueil des commémorations nationales 2008, https://france archives.fr/ commemo / recueil-2008 / 39850
BIBLIOGRAPHIE
- François LESURE, Dictionnaire musical des villes de province, Paris, Klincksieck, 1999, 367 p. [sur Montauban : p. 207-208]
- Philippe BACHET, Orgues en Midi-Pyrénées, tome 2 [Haute-Garonne sans Toulouse, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne], éd. Toulouse : Orgues méridionales,1982.
- Docteur de BERNARD, « L’œuvre de bienfaisance des Filles pauvres à marier de Sérignac, 1695-1795 », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1966, p. 65-77.
- Xavier BISARO, Chanter toujours. Plain-Chant et religion villageoise de la France Moderne (XVIe-XIXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, 246 p.
- Jean BOUTONNET, « La vie à Castelsarrasin au XVIIIe siècle », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1982, p. 100-116.
- Jean BOUTONNET, « À propos du mobilier de Saint-Sauveur de Castelsarrasin », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1986, p. 79-96.
- Jean BOUTONNET, Castelsarrasin...1789-1799 Révolutions, Castelsarrasin, Imprimerie Delpech, 1989, 261 p.
- Félix BOUVIER, « Le conventionnel Blaise LAURENT », Bulletin de la Société philomatique vosgienne, 1900, p. 103-116.
- Michel BRENET, Les concerts en France sous l’Ancien Régime, Paris, Fischbacher, 1900, 407 p.
- W. CHARRA, « Notes sur l’évolution des Causses du Quercy au cours du XIXe siècle », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, t. 20, année 1949, p. 175-221.
- Camille DAUX, Histoire de l’Église de Montauban, tome 2, Paris, Bray et Retaux, 1882, 3e et 4e périodes, p. 1-111.
- Camille DAUX, « Répertoire manuel de Mgr Le Tonnelier de Breteuil, État du diocèse de Montauban sur la fin du XVIIIe siècle », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1913, p. 97-126.
- Pierre DEFFONTAINES, « Montauban, études de géographie urbaine », Annales de géographie, année 1929, n° 215, p. 460-469
- DELAUX (docteur), Histoire de Saint-Martin-du-Touch (banlieue de Toulouse), Toulouse, imprimerie Saint-Cyprien, 1902, 264 p.
- Bernard DOMPNIER et Jean DURON (dir.), Le Métier du maître de musique (XVIIe-XVIIIe siècle), Activités, sociologie, carrières, Turnhout, Brepols, 2020, 424 p.
- Paul DURAND-LAPIE, « L’imprimerie Fontanel et Lapie-Fontanel à Montauban (1758-1861) », Recueil de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts du Tarn-et-Garonne, tome XVIII, 1902, p. 55-71.
- Jean-Claude FAU, « L’église Saint-Jean-Baptiste de Villenouvelle à Montauban », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1999, p. 141-153.
- Estelle FAYOLLE-BOUILLON, « Topographie de la ville de Moissac à la fin du Moyen Âge à partir des estimes de 1480 », Archéologie du Midi médiéval, 2011, n° 23, p 187-207.
- Émerand FORESTIÉ, Notices historiques ou éphémérides montalbanaises et du Tarn-et-Garonne, Montauban, Imprimerie Forestié, 1882, 296 p.
- Édouard FORESTIÉ, « Les vieilles orgues de Montauban », Bulletin archéologique du Tarn-et-Garonne, 1886, p. 9-18.
- Edmond GALABERT, « Notice biographique sur Jean-Baptiste Bonnet, violoniste et compositeur », Recueil de la Société des Sciences, belles-lettres et arts du Tarn-et-Garonne, 1880, p. 226-241.
- Firmin GALABERT, « Le mobilier de l’abbaye de Grandselve », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1900, p. 317-325.
- Firmin GALABERT, « Histoire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste Villenouvelle », Bulletin archéologique et Historique du Tarn-et-Garonne, 1917, p. 93-99.
- Firmin GALABERT, Montpezat-de-Quercy, sa collégiale, ses seigneurs, Saint-Dizier, éd. Jean Thévenot, 1918, 259 p.
- Jean-Michel GARRIC, Chronique de la Révolution à Montauban, 1788-1801, Montauban, CDDP de Tarn-et-Garonne, 2001, 389 p.
- Pierre GAYNE, Dictionnaire des paroisses du diocèse de Montauban, Montauban éditions de l’Association Montmurat-Montauriol, 1978, 310 p.
- Pierre GAYNE, « L’abbaye de Grandselve », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1949, p. 103-127.
- A. JOUGLAR, Monographie de l’abbaye de Mas-Grenier, ou de Saint-Pierre de la Cour, diocèse de Montauban, antérieurement de Toulouse, Toulouse, Delboy, 1864, 301 p.
- F. LABORIE (abbé), « Les subdélégations de Caussade en 1764 », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1911, p. 56-69.
- Adrien LAGRÈZE-FOSSAT, Études historiques sur Moissac, Paris, Librairie ancienne et moderne de J.-B. Dumoulin, 1870-1872, 3 tomes, 528-550-572 p.
- Michel LEMOUZY, « La chapelle de musique et l’orgue de Moissac », Bulletin de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne, 1995, p. 89-126.
- Loïc LEPREUX, Moissac au XVIIIe siècle, conférence donnée à Moissac, 21 janvier 2019, présentée par Danielle Bordes.
- Daniel LIGOU, « La cour des Aides de Montauban au XVIIIe siècle », Annales du Midi, 1952, t. 64, n° 20, p. 297-324.
- Daniel LIGOU, Montauban à la fin de l’Ancien Régime et aux débuts de la Révolution (1787-1794), Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1958, 719 p.
- Estelle MARTINAZZO, La Réforme Catholique dans le diocèse de Toulouse (1590-1710), thèse pour le doctorat en histoire, université Paul Valéry-Montpellier III, 2012, (« Des communautés sacerdotales en charge des fondations obituaires », p. 261-272).
- Louis MEUNIER-RIVIERE, Les orgues de Toulouse et de sa région du XVIe au début du XXe siècle, thèse de doctorat en musicologie, université de Paris-Sorbonne, 1997, 675 p.
- François MOULENQ, Département du Tarn-et-Garonne, documents historiques, 4 volumes, 1879-1894, réédition Paris, Res Universalis, 1991.
- Emmanuel MOUREAU, « La rénovation de l’église Saint-Jacques au XVIIIe siècle », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 2000, p. 97-104.
- Fernand POTTIER (abbé), « Ordonnance de la visite de la paroisse Saint-Jacques de Montauban, le 10 avril 1748 », Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1881, p. 177-190.
- Henry RICALENS, Moissac, du début du règne de Louis XIII à la fin de l’Ancien Régime, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse I Capitole, 1994, 234 p.
- Jean-Marie VIDAL, « Les origines de la province ecclésiastique de Toulouse (1295-1318) », Annales du Midi, 1904, t. 6, n° 61, p. 5-30.
- Louise WELTER, « Les communautés de prêtres dans le diocèse de Clermont du XIIIe au XVIIIe siècle », Revue d’histoire de l’Église de France, 1949, t. 35, n° 125, p. 9-35.